Assistants en Psycho : charlatans ou psychothérapeutes en devenir ?
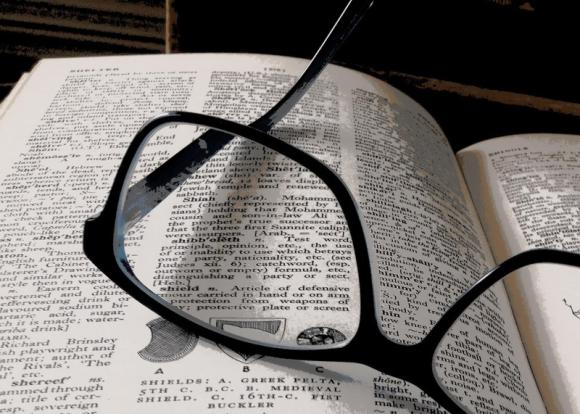
La loi De Block relative à l’exercice de la psychothérapie ébranle le secteur et questionne la légitimité de certains diplômés à exercer cet art. Parmi eux, les assistants en psychologie s’inquiètent.
L’art de la psychothérapie est un savoir faire qui demande une expertise professionnelle forte d’éthique et de prudence. De toute évidence, il nécessite un apprentissage spécifique qui, pour asseoir sa légitimité, devrait jouir d’une certification officielle et reconnue de tous. C’est à cela que s’attelle une succession de politiciens depuis de nombreuses années.
Alors que la formation relative à cet exercice était jusqu’alors ouverte à une série de professionnels de la santé mentale (psychologues, éducateurs, assistants sociaux, assistants en psychologie, etc.), elle n’accorde aujourd’hui de crédit qu’aux seuls médecins, psychologues ou orthopédagogues… Doit-on y voir une manière de suggérer l’inaptitude d’autres professionnels compétents ?
Focus sur le cas particuliers des Assistants en Psychologie.
Fabienne Deschoenmaecker est présidente de l’association des praticiens en psychologie appliquée et chef du département en psychologie de l’institut Libre Marie Haps. Jean Verriest est psychologue, psychothérapeute et maitre-assistant à la Haute Ecole De Vinci.
Fabian Cantaert est maître de formation pratique en psychologie appliquée à la Haute École Léonard de Vinci.
Loi et quête de justes places
Rappelons que la dernière loi relative à la psychothérapie s’appuie sur le souci d’évincer tous les charlatans exerçant jusqu’alors sans reconnaissance officielle. Cependant, pour entamer le chantier, le Cabinet de la ministre s’est référé uniquement aux fédérations de psychologues, ce qui sous-entendait, comme le suggère Fabienne Deschoenmaecker, que les autres praticiens pouvaient être suspectés de charlatanisme… « Aujourd’hui la ministre semble se rendre compte que ce n’est pas tout à fait le cas : les bacheliers assistants en psychologie ne sont pas des charlatans, et il faut leur trouver une juste place ». Et d’ajouter : « Ce serait dommage qu’on ferme les portes à nos étudiants sous l’idée qu’ils n’ont pas le master et qu’ils ne peuvent pas accéder à ces formations-là. C’est difficilement acceptable. Ils auraient peut-être besoin de cours supplémentaires mais ils devraient à terme pouvoir rejoindre ces écoles ».
Tenir compte de l’histoire, c’est s’assurer un avenir éclairé
Pour comprendre un peu mieux les tenants et aboutissants du contexte actuel, Jean Verriest attire notre attention sur un fait important : « On ne peut comprendre ce qui se passe aujourd’hui qu’en tenant compte de l’histoire ». Et de se saisir d’une question éclairante : « La fédération belge des psychologues ne s’appelle pas la fédération belge de psychologie : pourquoi ? ». On sent y poindre des enjeux identitaires… Et ces enjeux sont omniprésents dans l’histoire du débat. Or, quand il y a des questions identitaires, la première tendance humaine est de se définir en rejetant l’autre.
Pour le professeur, « Historiquement, il y a eu pendant très longtemps un imaginaire construit en termes de rejet : « Je suis psychologue mais pas toi », « Je suis un praticien et pas un théoricien » » Fait étonnant pour des acteurs de l’aide…
Le choix d’une grille de lecture peu rassurante
Pour Fabian Cantaert, si le souci de définir une juste place pour les assistants en psychologie est déjà une avancée, il subsiste une inquiétude quant au choix de la grille de lecture engagée dans la loi : « je ne partage pas cette grille de lecture car elle vise à quantifier les choses et la santé mentale traite de choses non quantifiables ». Selon lui, « La question de la parole et du transfert est tout à fait évincée. Or, la plupart des intervenants sont d’accords pour dire qu’il y a quelque chose dans la relation qui se joue… l’evidence based ne tient pas compte de ça, du champ de la parole. Pour moi, ça représente un danger considérable ». Cette idée apparaît de façon secondaire dans la loi au travers de la motion « les valeurs accordées par le patient », et c’est bien ça le problème : une telle dimension ne peut décemment pas être prise en compte en second plan.
Inquiétude sociologique
Pour Jean Verriest, « C’est pas ton titre qui te rend intelligent. Des charlatans, il y en a autant du coté des bacheliers que des masters. Il y en a qui ont une conscience professionnelle et d’autres moins ». Et d’ajouter : « Nous sommes dans une société où on a tendance à dire que si on n’a pas fait l’université, on est personne. La mise en danger du titre d’assistant en psycho met en danger la dimension d’ascenseur social. Il y a des étudiants qui sont intéressés par le monde de la psychologie, mais qui ne souhaitent pas le faire en passant par l’université, ou qui n’ont tout simplement pas les moyens de financer 5 ans à l’université. Si on mure toutes les portes et qu’on en désigne, sur la base d’une loi, une seule et unique voie, je trouve que c’est inquiétant au niveau sociétal. C’est un signe de fermeture de la société ».
Constat d’un impossible idéal
L’idée d’évincer les charlatans dans la loi est une idée très noble, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle des ministres se succèdent depuis près de 20 ans pour la concrétiser. Cela dit, Jean Verriest se questionne : « Toutes les personnes qui ont réussi leur permis de conduire respectent-elles pour autant le code de la route ? ». La loi est nécessaire parce que c’est aussi la parole d’un choix de société, mais elle n’évincera jamais les charlatans. Pour Jean Verriest, il suffit de voir : « Les charlatans se décalent immédiatement. On parle de thérapeutes, nutrithérapeutes, coachs… Hier ces personnes s’appelaient psychothérapeutes. Celui qui ne veut pas avoir de conscience professionnelle trouvera toujours la parade. »
Espoir et optimisme
Se pencher sur la situation socio-politique actuelle a sans doute vertu de soulever davantage de questions, voire de révoltes. Cela dit, rappelons-nous que les représentants d’une cause juste sont toujours guidés par une forme de bienveillance. Celle qu’ils accordent à leurs compagnons de route (leurs confrères), au public pour lequel ils s’engagent, mais aussi pour leurs partenaires de terrain. A ce titre, Jean Verriest l’assure : « La confiance est toujours au bout du chemin. Que ce soit dans l’organisation concrète au niveau institutionnel ou dans l’application sur le terrain des mesures légales prises de manière très claire… La collaboration, la multidisciplinarité, la liberté… Trouveront toujours des canaux qui leurs conviennent ».
L.T. assistante en psychologie
[Du même auteur]
– Assistants en psychologie : nom d’un titre !
– Loi De Block : les assistants psy se redéfinissent
– Evidence-based practice et psychothérapie, pour quel débat ?
– Aide à la Jeunesse et Formation Continuée : un devoir à valoriser
– Mes mentors, ces héros !
– Assistant en psychologie : et si on s’appelait autrement ?
– Cycles de vie : des phénomènes institutionnels aussi !
– Comment bien choisir sa formation dans le social ?
– Jeune travailleur en institution : qu’est-ce qui fait autorité ?
– La transmission du savoir en équipe, un jeu de chaises musicales ?
– Séjours de Non-Rupture : une redécouverte de soi et de l’autre
– Vers une répartition plus juste des places dans l’aide à la jeunesse
– Séjours de rupture : des éducateurs à l’initiative d’une expérience transversale
– Le Non-renvoi : modèle incontournable et audacieux dans l’Aide à la Jeunesse
– Fugue : les outils pédagogiques nous aident-ils à faire avec l’impuissance ?
– "L’utilisation de soi en institution de l’Aide à la Jeunesse"
– Acteurs de l’aide en milieu ouvert : je ne mords pas !
– Mais vous êtes quoi au juste ? : à quand une reconnaissance du métier d’assistant en psychologie ?
– Vers des relations nouvelles grâce aux séjours de rupture
– Pour une réflexion éthique de l’aide contrainte des mineurs
– API et SAMIO : même combat ?


Ajouter un commentaire à l'article